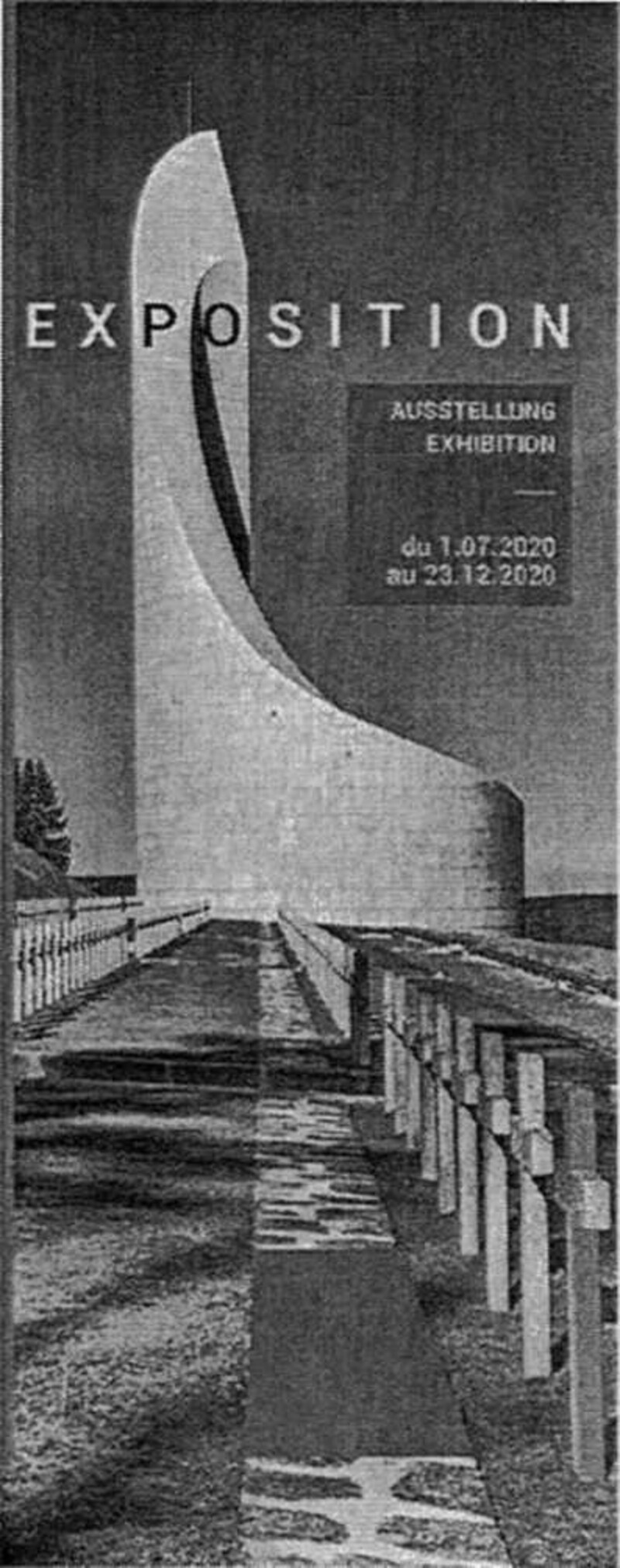Programme du Conseil national de la Résistance
(15 mars 1944)
Née de la volonté ardente des Français de refuser la défaite, la Résistance n’a pas d’autre raison d’être que la lutte quotidienne sans cesse intensifiée.
Cette mission de combat ne doit pas prendre fin à la Libération. Ce n’est, en effet, qu’en regroupant toutes ses forces autour des aspirations quasi unanimes de la
Nation, que la France retrouvera son équilibre moral et social et redonnera au monde l’image de sa grandeur et la preuve de son unité.
Aussi les représentants des organisations de la Résistance, des centrales syndicales et des partis ou tendances politiques groupés au sein du C.N.R., délibérant en assemblée plénière le 15 mars 1944, ont-ils décidé de s’unir sur le programme suivant, qui comporte à la fois un plan d’action immédiate contre l’oppresseur et les mesures destinées à instaurer, dès la Libération du territoire, un ordre social plus juste.
I - PLAN D’ACTION IMMÉDIATE
Les représentants des organisations de résistance, des centrales syndicales et des partis ou tendances politiques groupés au sein du C.N.R.
Expriment leur angoisse devant la destruction physique de la Nation que l’oppresseur hitlérien poursuit avec l’aide des hommes de Vichy, par le pillage, par la suppression de toute production utile aux Français, par la famine organisée, par le maintien dans les camps d’un million de prisonniers, par la déportation d’ouvriers au nombre de plusieurs centaines de milliers, par l’emprisonnement de 300.000 Français et par l’exécution des patriotes les plus valeureux, dont déjà plus de 50.000 sont tombés pour la France.
Ils proclament leur volonté de délivrer la patrie en collaborant étroitement aux opérations militaires que l’armée française et les armées alliées entreprendront sur le continent, mais aussi de hâter cette libération, d’abréger les souffrances de notre peuple, de sauver l’avenir de la France en intensifiant sans cesse et par tous les moyens la lutte contre l’envahisseur et ses agents, commencée dès 1940.
Ils adjurent les gouvernements anglais et américain de ne pas décevoir plus longtemps l’espoir et la confiance que la France, comme tous les peuples opprimés de l’Europe, a placés dans leur volonté d’abattre l’Allemagne nazie, par le déclenchement d’opérations militaires de grande envergure qui assureront, aussi vite que possible, la libération des territoires envahis et permettront ainsi aux Français qui sont sur notre sol de se joindre aux armées alliées pour l’épreuve décisive.
Ils insistent auprès du Comité Français de la Libération Nationale pour qu’il mette tout en œuvre afin d’obtenir les armes nécessaires et de les mettre à la disposition des patriotes. Ils constatent que les Français qui ont su organiser la résistance ne veulent pas et d’ailleurs ne peuvent pas se contenter d’une attitude passive dans l’attente d’une aide extérieure, mais qu’ils veulent faire la guerre, qu’ils veulent et qu’ils doivent développer leur résistance armée contre l’envahisseur et contre l’oppresseur.
Ils constatent, en outre, que la Résistance Française doit ou se battre ou disparaître qu’après avoir agi de façon défensive, elle a pris maintenant un caractère offensif et que seuls le développement et la généralisation de l’offensive des Français contre l’ennemi lui permettront de subsister et de vaincre
Ils constatent enfin que la multiplication des grèves, l’ampleur des arrêts de travail le 11 Novembre qui, dans beaucoup de cas, ont été réalisés dans l’union des patrons et des ouvriers, l’échec infligé au plan de déportation des jeunes français en Allemagne, le magnifique combat que mènent tous les jours, avec l’appui des populations, dans les Alpes, dans le Massif Central, dans les Pyrénées et dans les Cévennes, les jeunes Français des maquis, avant garde de l’armée de la Libération, démontrent avec éclat que notre peuple est tout entier engagé dans la lutte et qu’il doit poursuivre et accroître cette lutte.
En conséquence, les représentants des organisations de résistance, des centrales syndicales et des partis ou tendances politiques groupés au sein du C.N.R.
Déclarent que c’est seulement par l’organisation, l’intensification de la lutte menée
par les forces armées, par les organisations constituées, par les masses, que pourra être réalisée l’union véritable de toutes les forces patriotiques pour la réalisation de la libération nationale inséparable, comme l’a dit le Général De Gaulle, de l’insurrection nationale qui, ainsi préparée, sera dirigée par le C.N.R, sous l’autorité du C.F.L.N, dès que les circonstances politiques et militaires permettront d’assurer, même au prix de lourds sacrifices, son succès.
Ils ont l’espoir que les opérations de la Libération du pays, prévues par le plan del’état major interallié, pourront ainsi être, le cas échéant, avancées grâce à l’aide apportée par les Français dans la lutte engagée contre l’ennemi commun, ainsi que l’a démontré l’exemple glorieux des patriotes corses.
Ils affirment solennellement que la France qui, malgré l’armistice, a poursuivi sans trêve la guerre, entend plus que jamais développer la lutte pour participer à la libération et à la victoire.
Pour mobiliser les ressources immenses d’énergie du peuple français, pour les diriger vers l’action salvatrice dans l’union de toutes les volontés, le C.N.R décide :
D’inviter les responsables des organisations déjà existantes à former des comités de villes et de villages, d’entreprises, par la coordination des formations qui existent actuellement, par la formation de comités là où rien n’existe encore et à enrôler les patriotes non organisés.
Tous ces comités seront placés sous la direction de s comités départementaux de la libération (C.D.L). Ils seront soumis à l’autorité des C.D.L qui leur transmettront, comme directives, la plate-forme d’action et la ligne politique déterminée par le C.N.R.
Le but de ces comités sera, à l’échelon communal, local et d’entreprise, de faire participer de façon effective tous les Français à la lutte contre l’ennemi et contre ses agents de Vichy, aussi bien par la solidarité et l’assistance active à l’égard des patriotes sous l’impulsion et le soutien donnés aux revendications vitales de notre peuple. Par-dessus tout, leur tâche essentielle sera de mobiliser et d’entraîner les Français qu’ils auront su grouper à l’action armée pour la Libération.
Ces comités devront, selon les circonstances et en se conformant aux instructions données par les C.D.L, appuyer et guider toutes les actions menées par les Français contre toutes les formes d’oppression et d’exploitation imposées par l’ennemi, de l’extérieur et de l’intérieur.
Ces comités devront :
1) Développer la lutte contre la déportation et aider les réfractaires à se cacher, à se nourrir, à se vêtir et à se défendre, enlevant ainsi des forces à l’ennemi et augmentant le potentiel humain de la résistance ;
2) Traquer et punir les agents de la Gestapo et de la Milice de DARNAND ainsi que les mouchards et les traîtres ;
3) Développer l’esprit de lutte effective en vue de la répression des nazis et des fascistes français ;
4) Développer, d’une part, la solidarité envers les emprisonnés et déportés ; d’autre part, la solidarité envers les familles de toutes les victimes de la terreur hitlérienne et vichyssoise ;
5) En accord avec les organisations syndicales résistantes, combattre pour la vie et la santé des Français pour une lutte quotidienne et incessante, par des pétitions, des manifestations et des grèves, afin d’obtenir l’augmentation des salaires et traitements, bloqués par Vichy et les Allemands, et des rations alimentaires et attributions de produits de première qualité, réduites par la réglementation de Vichy et les réquisitions de l’ennemi, de façon à rendre à la population un minimum de vital en matière d’alimentation, de chauffage et d’habillement ;
6) Défendre les conditions de vie des anciens combattants, des prisonniers, des femmes de prisonniers, en organisant la lutte pour toutes les revendications particulières ;
7) Mener la lutte contre les réquisitions de produits agricoles, de matières premières et d’installations industrielles pour le compte de l’ennemi ; saboter et paralyser la production destinée à l’ennemi et ses transports par routes, par fer et par eau ;
8) Défendre à l’intérieur de la corporation agricole les producteurs contre les prélèvements excessifs, contre les taxes insuffisantes, et lutter pour le remplacement des syndicats à la solde de Vichy et de l’Allemagne par des paysans dévoués à la cause de la paysannerie française.
Tout en luttant de cette façon et grâce à l’appui de solidarité et de combativité que développe cette lutte, les comités de villes, de villages et d’entreprises devront en outre :
a) Renforcer les organisations armées des Forces Françaises de l’Intérieur par l’accroissement des groupes de patriotes : groupes francs, francs-tireurs et partisans, recrutés en particulier parmi les réfractaires ;
b) En accord avec les états-majors nationaux, régionaux et départementaux des F.F.I, organiser des milices patriotiques dans les villes, les campagnes et les entreprises, dont l’encadrement sera facilité par des ingénieurs, techniciens, instituteurs, fonctionnaires et cadres de réserve, et qui sont destinés à défendre l’ordre public, la vie et les biens des Français contre la terreur et la provocation, assurer et maintenir l’établissement effectif de l’autorité des Comités départementaux de la Libération sur tout ce qui aura été ou sera créé dans ce domaine pour le strict rattachement aux F.F.I dont l’autorité et la discipline doivent être respectées par tous.
Pour assurer la pleine efficacité des mesures énoncées ci-dessus, le C.N.R prescrit de l’état-major national des Forces Françaises de l’Intérieur, tout en préparant minutieusement la coopération avec les Alliés en cas de débarquement, doit :
1) Donner ordre à toutes les formations des F.F.I de combattre dès maintenant l’ennemi en harcelant ses troupes, en paralysant ses transports, ses communications et ses productions de guerre, en capturant ses dépôts d’armes et de munitions afin d’en pourvoir les patriotes encore désarmés ;
2) Faire distribuer les dépôts d’armes encore inutilisés aux formations jugées par lui les plus aptes à se battre utilement dès à présent et dans l’avenir immédiat ;
3) Organiser de façon rationnelle la lutte suivant un plan établi avec les autorités compétentes à l’échelon régional, départemental ou local, pour obtenir le maximum d’efficacité ;
4) Coordonner l’action militaire avec l’action de résistance de la masse de la nation en proposant pour but aux organisations régionales paramilitaires d’appuyer et de protéger les manifestations patriotiques, les mouvements revendicatifs des femmes de prisonniers, des paysans et des ouvriers contre la police hitlérienne, d’empêcher les réquisitions de vivres et d’installations industrielles, les rafles organisées contre les réfractaires et les ouvriers en grève et défendre la vie et la liberté de tous les Français contre la barbare oppression de l’occupant provisoire.
Ainsi, par l’application des décisions du présent programme d’action commune, se fera, dans l’action, l’union étroite de tous les patriotes, sans distinction d’opinions politiques, philosophiques ou religieuses. Ainsi se constituera dans la lutte une armée expérimentée, rompue au combat, dirigée par des cadres éprouvés devant le danger, une armée capable de jouer son rôle lorsque les conditions de l’insurrection nationale seront réalisées, armée qui élargira progressivement ses objectifs et son armement.
Ainsi, par l’effort et les sacrifices de tous, sera avancée l’heure de la libération du territoire national ; ainsi la vie de milliers de Français pourra être sauvée et d’immenses richesses pourront être préservées.
Ainsi dans le combat se forgera une France plus pure et plus forte capable d’entreprendre au lendemain de la libération la plus grande œuvre de reconstruction et de rénovation de la patrie.
II - MESURES À APPLIQUER DÈS LA LIBÉRATION DU TERRITOIRE
Unis quant au but à atteindre, unis quant aux moyens à mettre en œuvre pour atteindre ce but qui est la libération rapide du territoire, les représentants des mouvements, groupements, partis ou tendances politiques groupés au sein du C.N.R proclament qu’ils sont décidés à rester unis après la libération :
1) Afin d’établir le gouvernement provisoire de la République formé par le Général de Gaulle pour défendre l’indépendance politique et économique de la nation, rétablir la France dans sa puissance, dans sa grandeur et dans sa mission universelle ;
2) Afin de veiller au châtiment des traîtres et à l’éviction dans le domaine de l’administration et de la vie professionnelle de tous ceux qui auront pactisé avec l’ennemi ou qui se seront associés activement à la politique des gouvernements de collaboration ;
3) Afin d’exiger la confiscation des biens des traîtres et des trafiquants de marché noir, l’établissement d’un impôt progressif sur les bénéfices de guerre et plus généralement sur les gains réalisés au détriment du peuple et de la nation pendant la période d’occupation ainsi que la confiscation de tous les biens ennemis y compris les participations acquises depuis l’armistice par les gouvernements de l’axe et par leurs ressortissants, dans les entreprises françaises et coloniales de tout ordre, avec constitution de ces participations en patrimoine national inaliénable ;
4) Afin d’assurer :
- l’établissement de la démocratie la plus large en rendant la parole au peuple français par le rétablissement du suffrage universel ;
- la pleine liberté de pensée, de conscience et d’expression ;
- la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l’égard de l’Etat, des puissances d’argent et des influences étrangères ;
- la liberté d’association, de réunion et de manifestation ;
- l’inviolabilité du domicile et le secret de la correspondance ;
- le respect de la personne humaine ;
- l’égalité absolue de tous les citoyens devant la
loi ;
5) Afin de promouvoir les réformes indispensables :
a) Sur le plan économique :
- l’instauration d’une véritable démocratie économique et sociale, impliquant l’éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l’économie ;
- une organisation rationnelle de l’économie assurant la subordination des intérêts particuliers à l’intérêt général et affranchie de la dictature professionnelle instaurée à l’image des Etats fascistes ;
- l’intensification de la production nationale selon les lignes d’un plan arrêté par l’Etat après consultation des représentants de tous les éléments de cette production ;
- le retour à la nation des grands moyens de production monopolisée, fruits du travail commun, des sources d’énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d’assurances et des grandes banques ;
- le développement et le soutien des coopératives de production, d’achats et de ventes, agricoles et artisanales ;
- le droit d’accès, dans le cadre de l’entreprise, aux fonctions de direction et d’administration, pour les ouvriers possédant les qualifications nécessaires, et la participation des travailleurs à la direction de l’économie.
b) Sur le plan social :
- le droit au travail et le droit au repos, notamment par le rétablissement et l’amélioration du régime contractuel du travail ;
- un rajustement important des salaires et la garantie d’un niveau de salaire et de traitement qui assure à chaque travailleur et à sa famille la sécurité, la dignité et la possibilité d’une vie pleinement humaine ;
- la garantie du pouvoir d’achat national pour une politique tendant à une stabilité de la monnaie ;
- la reconstitution, dans ses libertés traditionnelles, d’un syndicalisme indépendant, doté de larges pouvoirs dans l’organisation de la vie économique et sociale ;
- un plan complet de sécurité sociale, visant à assurer à tous les citoyens des moyens d’existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l’État ;
- la sécurité de l’emploi, la réglementation des conditions d’embauchage et de licenciement, le rétablissement des délégués d’atelier ;
- l’élévation et la sécurité du niveau de vie des travailleurs de la terre par une politique de prix agricoles rémunérateurs, améliorant et généralisant l’expérience de l’Office du blé, par une législation sociale accord ant aux salariés agricoles les mêmes droits qu’aux salariés de l’industrie, par un système d’assurance conte les calamités agricoles, par l’établissement d’un juste statut du fermage et du métayage, par des facilités d’accession à la propriété pour les jeunes familles paysannes et par la réalisation d’un plan d’équipement rural ;
- une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours ;
- le dédommagement des sinistrés et des allocations et pensions pour les victimes de la terreur fasciste.
c) Une extension des droits politiques, sociaux et économiques des populations indigènes et coloniales.
d) La possibilité effective pour tous les enfants français de bénéficier de l’instruction et d’accéder à la culture la plus développée, quelle que soit la situation de fortune de leurs parents, afin que les fonctions les plus hautes soient réellement accessibles à tous ceux qui auront les capacités requises pour les exercer et que soit ainsi promue une élite véritable, non de naissance mais de mérite, et constamment renouvelée par les apports populaires.
Ainsi sera fondée une République nouvelle qui balaiera le régime de basse réaction instauré par Vichy et qui rendra aux institutions démocratiques et populaires l’efficacité que leur avaient fait perdre les entreprises de corruption et de trahison qui ont précédé la capitulation.
Ainsi sera rendue possible une démocratie qui unisse au contrôle effectif exercé par les élus du peuple la continuité de l’action gouvernementale.
L’union des représentants de la Résistance pour l’action dans le présent et dans l’avenir, dans l’intérêt supérieur de la patrie, doit être pour tous les Français un gage de confiance et un stimulant. Elle doit les incitera à éliminer tout esprit de particularisme, tout ferment de division qui pourrait freiner leur action et ne servir que l’ennemi.
En avant donc, dans l’union de tous les Français rassemblés autour du C.F.L.N et de son président le général De Gaulle !
En avant pour le combat, en avant pour la victoire afin que VIVE LA FRANCE !
LE CONSEIL NATIONAL DE LA RÉSISTANCE