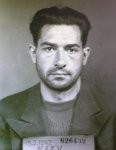Mont-Valérien
Mont-Valérien

Mont-Valérien : Ancien lieu d'ermitage avant de devenir un élément clé des fortifications de Paris au XIXe, le Mont-Valérien, dans le département des Hauts-de-Seine, connaît une histoire aussi tragique que poignante lors de la Seconde Guerre Mondiale.
Après la défaite et l'armistice du 22 juin 1940, la France est divisée en plusieurs zones :
Ø La zone nord est occupée par l'armée allemande,
Ø La zone sud est occupée par le nouvel "Etat français", qui a installé son siège à Vichy,
Ø La zone militaire du littorale (mur du l’atlantique),
Ø La zone annexée à l’Allemagne,
Ø La zone d’occupation Italienne
Ø La zone administrée militairement de la Belgique et du Nord,
Ø La zone démilitarisée à hauteur de la Suisse.
Le commandement militaire allemand en France occupée (Militärbefehlshaber in Frankreich - MBF) met immédiatement en place un arsenal répressif pour assurer la sécurité de ses troupes et le maintien de l'ordre.
Face aux premiers actes de résistance de ceux qui refusent l'Occupation, la répression est immédiate et sévère. Dès 1941, le MBF fait du Mont-Valérien un des lieux d'exécution, attaché à la région parisienne, des résistants condamnés à mort par un tribunal militaire allemand, puis des otages désignés en représailles aux attentats commis contre des soldats.
De 1941 à 1944, ce ne sont pas moins de 1009 résistants et otages qui sont fusillés par l'occupant nazi. Parmi les fusillés du Mont-Valérien, 40% étaient des otages, 60% étaient des condamnés à mort jugés par les tribunaux militaires allemands. 63% d’entre eux étaient communistes, 17% étaient juifs et 20% étrangers.
Au sortir de la Guerre, le Général de Gaulle inaugure en 1960 le monumental Mémorial de la France combattante afin de rendre hommage aux nombreuses victimes.
Au cœur de ce lieu que l'on peut visiter toute l'année, vous pourrez découvrir différents vestiges de l'histoire. La clairière des fusillés est le lieu où se déroulèrent les exécutions. Non loin se trouve la chapelle des fusillés dans laquelle certains condamnés étaient retenus en attente de leur supplice. Des graffitis, témoignages poignants toujours visibles aujourd'hui, recouvrent les murs de l'ancienne chapelle.
Sur les, sans doute, 9.000 cheminots morts pendant la 2ème guerre mondiale, toutes causes confondues, une majorité de ces victimes l’ont été lors des bombardements et des mitraillages des trains par les alliés.
Il y a Cependant :
Ø2.229 cheminots qui ont été « tués victimes de la répression », à cela s’ajoute,
Ø 244 cheminots « tués au combat »,
Ø 112 cheminots « tués pendant les combats » souvent parce qu’ils se trouvaient au mauvais endroit, au mauvais moment et enfin
Ø 87 cheminots « tués sous l’uniforme ».
Additionnés, ces recensements des victimes de la répression et celles des combats de la libération aboutissent ainsi à dénombrer 2.672 cheminots tués.
Au Mont Valérien ce ne sont pas moins de 57 Cheminots qui furent exécutés pour leurs appartenances politiques, syndicales ou comme otages désignés en représailles aux attentats commis contre des soldats.
Ø 05 en 1941
Ø29 en 1942
Ø16 en 1943
Ø07 en 1944
Le plus jeune des condamnés cheminots, Jean BOSC, avait 18 ans, le plus vieux, Roland RICHON, 54 ans. Ces 57 cheminots venaient de 33 départements Français différents du Nord au Sud et de l’Ouest à l’Est.
Au delà du fait d’être patriote et de refuser dès le début l’occupation Nazi, il faut se rappeler que beaucoup de cheminots furent arrêtés, torturés et à la fin, supprimés pour leurs appartenances politiques et/ou syndicales.
La transmission de l’histoire doit être sans cesse renouvelée pour que personne ne l’ignore. C’est le devoir de mémoire et celui-ci est essentiel pour que le sacrifice des cheminots, comme de tous ceux qui se sont opposés au fascisme, ne soit pas oublié.
Ce recueil a pour objectif ou mission de vous raconter leurs « aventures » et leurs histoires en parcourant les différentes archives a disposition.
Les noms des Cheminots, ci-dessous, sont repris dans le livre « Cheminots victimes de la répression 1940-1945 - Mémorial ».
Cet ouvrage est le résultat d’une recherche souhaitée par la SNCF et coordonnée de 2012 à 2017 par Rails & Histoire en partenariat avec, entre autres, IHS CGT Cheminots et l’ANCAC.